Le retour au pays natal dans le regard d'Anouchka Agbayissah.
- ASRAR & Co
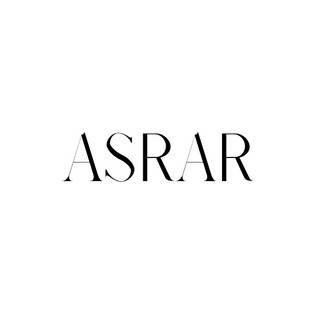
- 15 sept. 2025
- 6 min de lecture
Dernière mise à jour : 15 oct. 2025

De manière générale, nous observons les débuts d’une révolution sur le plan culturel – bien que lente, celle-ci est légitime à plusieurs égards en ce qui concerne les thèmes et formes d’expression propres dont nous nous étions considérablement éloignés en raison d’une profusion de diktats conceptuels, et d’impérialisme couvert d’universalisme abstrait.
Ce retour à soi signifie donc chez nos artistes, non seulement un impératif créatif d’acter par le fait de l’art le séisme du monde qui agit en eux et qui bouleverse, comme nous le voyons, tout le champ social de ces dix dernières années ; mais aussi et surtout, signifie par l'émergence de certaines façons inédites de façonner l’imaginaire de la femme afro-européenne, une nouvelle tentative par un processus d’activation d’une conscience historique pour combler le trou béant de nos insuffisances. Ces insuffisances sont symptomatiques et représentatives de l’absence criarde de voix féminines dans les institutions culturelles, et symbolisent son exclusion systématique au cœur de la fabrication de nouveaux récits du monde en marche.
À la manœuvre d’une conversion des plus inattendues – Anouchka Agbayissah, ancienne juriste mue en photographe, à ceci près d’être plasticienne, questionne d’ores et déjà les contours des disciplines qu’elle convoque, les ouvrant à une élasticité où matières et récits se conjuguent au présent de son histoire. Une histoire qui se déplie sous nos yeux par une série, posant ainsi un diagnostic sur l’état intime de la personne africaine, à travers sa figure féminine diasporique.
Voilà la compréhension telle que vécue que vous pourriez vous faire après rencontre de l’art d’Anouchka. Notre conversation débute ainsi dans son atelier au mois de juillet à Pantin. Riche dès lors qu’en chemin nous nous arrêtions, le pas lent, sur des interrogations communes ; sur les structures de l’art et leurs points de bascule que promettent les engagements inédits des artistes et leurs désirs de renversements des structures ontologiques de la diaspora qui font loi tant en eux qu’en leurs œuvres. Dès lors, il était clair que nous devions, par nos sensibilités en écho, faire pont entre son œil prometteur et notre approche d'investigation critique et historico-esthétique, tirer portrait de l'état de la photographie diasporique actuelle.
Trois visages, trois regards et toutes les intentions de l’artiste se déploient. Dans cette œuvre à taille humaine, l’artiste atteste la nécessité d’exister par un ancrage dans ses traditions. En effet, composé de deux photographies d’archives de sa grand-mère et de son grand-père, ainsi que d'un autoportrait au centre, Anouchka nous plonge dans une quête de réenracinement avec son histoire familiale dont elle acte par un voyage-retour dans les pays de ses ancêtres. Dans un langage symbolique minutieusement travaillé aux accents familiers du peuple yoruba, l’Akọ́ṣe est la notion principale à laquelle l’artiste nous initie. Il s’agit en effet, nous explique Anouchka, d’une envolée profonde dans les degrés les plus hauts de la spiritualité dans laquelle chaque individu navigue, ayant pour maître-navire son “Ori” (destin), regardant pour terre promise son Être réalisé.
Sur ce triptyque y figure également trois couleurs emblématiques des philosophies Fon et Yoruba : le rouge, le noir et le solennel blanc. Pour l’artiste, ces couleurs portent en elles de véritables, dixit, “vecteurs de mémoires”. Le rouge symbolise la vitalité, celui du sang qui nous traverse et qui se verse lors d’une lutte. Le noir, celui de la nuit, lieu de tous les mystères mais aussi d’un temps où tout se régénère. Et enfin, le blanc étendard de la clarté et de la spiritualité guidant les âmes vers une merci.

A.M : Où commencent tes débuts dans l’art et as-tu connu des moments fondateurs dans ta démarche artistique ?
Anouchka A. : Nous sommes tous frappés par la pandémie COVID. Les boîtes n’embauchent plus.
J’ai donc répondu à cet appel en finissant mon dernier stage au Togo. J’y resterai finalement un an et trois mois où je vais alterner entre Togo, Bénin et un peu Ghana à la rencontre de ces territoires méconnus et connus. De ses visages, de ses plats, de ces paysages. Un moment de reconnexion totale.
J’ai pour pratique ou pour habitude de toujours documenter là où je vais, et ce que je vois. C’est une pratique qui m’a été donnée depuis petite.
J’ai donc documenté toutes ces rencontres. Et lors de cette reconnexion, j’ai aussi pris le temps de parcourir les archives de mes deux familles côté paternel, d’abord, et maternel ensuite. En voyant la quantité de photographies, ces fragments de mémoire, j’ai compris alors que je n’avais pas choisi la photographie. J’ai compris qu’elle m’a vraiment été transmise comme moyen de raconter nos vies. Que ce soit du côté paternel ou maternel, nous avons un énorme patrimoine photographique qui, bien évidemment, fait partie des fondations de ma pratique artistique.
Ce retour aux sources est donc catalyseur d’un cheminement personnel, mais aussi dans l'avènement de ma démarche et de ma pratique.”
A.M : Votre travail s’enracine sur un pléthore de techniques traditionnelles, quelle est la place de l’histoire et quel est l’impact qu’il a pu avoir dans la formalisation de vos images ?
Anouchka A. : Lors de mon périple de reconnexion, je suis allée avec ma famille au royaume de Savalou (Bénin). D’ailleurs, mon grand-père maternel était de cette région-là entre Savalou et Abomey. J’ai été particulièrement saisie par l’un des symboles sur le palais, celui de la corde : « c’est avec l’ancienne corde que l’on tresse la nouvelle ». C’est avec le passé que l’on peut mieux appréhender le futur. D’une part, c’est ce qui explique pourquoi je pars des archives familiales, d’autre part, c’est pourquoi j’utilise le textile, le fil comme symbole de lien entre les générations passées et à venir.
De plus, j’utilise le textile comme une forme permettant de faire vivre les histoires que je souhaite raconter. C’est un médium appelant les sens grâce à la matière, la texture. Cela laisse place à une immersion dans ma démarche.”
A.M : Où situez-vous le récit personnel dans la scénographie générale de votre travail qui, comme vous l'avez rappelé précédemment, prend racine d’abord dans l’histoire, quel est le sens individuel que vous donnez à votre approche de recherche et l’importance que ça a eu dans votre vie ?
Anouchka A.: J’ai toujours adoré raconter les histoires des autres, notamment à travers la photographie et l’audiovisuel. J’adore être une plateforme pour permettre aux autres de raconter leur histoire, mais pour faire ça il faut aussi que je raconte ma propre histoire, c’est donc l’un des autres fondements de ma pratique : mon histoire.
C’est pourquoi j’explore donc mon cheminement personnel, au travers du prisme du retour aux sources de la mémoire, mais aussi de l’authenticité. J’ai intitulé ce projet The Homecoming Journey pour signifier le retour aux sources, mais aussi le retour à soi. J’écrivais aux prémices de ce projet que je voulais parler justement de ce que ça signifie d’être chez soi culturellement, mais aussi émotionnellement et spirituellement.
Aujourd’hui, avec la mondialisation que nous connaissons, nous sommes en effet le produit d’une histoire complexe, et on peut être très vite pris par le flot des perceptions erronées, lorsque nous ne nous ancrons pas à nos racines. C’est donc une invitation à reconnecter à nos sources.”
A.M : Comment avez-vous construit le dialogue entre la photographie et les archives, et de manière générale quelle est la place des archives dans votre pratique de la photographie ?
Anouchka A. : J’ai choisi d’accoupler ces archives à ma propre photo d’identité, pour confronter ces temporalités. Pour mettre en dialogue l’héritage reçu, une tradition transmise (celle de se rendre au studio photographe pour immortaliser le moment) et le corps qui le porte aujourd’hui.
Ce face-à-face n’est pas une juxtaposition : c’est une tentative de réunification. Une manière de dire que la transmission ne passe pas que par le sang, mais aussi par le regard, par l’image, par le geste. Chaque collage, chaque impression devient alors un témoin de passage. Un terrain où le passé ne se contente pas d’être révélé, mais se métamorphose en futur. En travaillant avec ces images — les leurs et la mienne — je ne cherche pas à illustrer une filiation. Je tente de l’activer, d’en faire un langage. Une transmission vivante. Archives vivantes, futurs enracinés…
A.M : Pouvez-vous nous parler de vos recherches techniques et des savoir-faire appliqués dans vos images et de votre relation en tant que photographe avec les matériaux de vos cultures respectives ?
Anouchka A. : Dans ce travail, la mousseline de coton, tissu léger, aérien et largement utilisé au Bénin, devient un support central. Choisie pour sa douceur, sa transparence, mais aussi pour son ancrage local, elle agit comme un voile entre les mondes. Elle laisse passer la lumière, révèle sans tout dévoiler, évoque l’intangible autant que l’intime. En imprimant mes images sur ce tissu, je cherche à matérialiser la fragilité et la puissance du lien — entre générations, entre continents, entre mémoires. La mousseline devient le lieu d’un souffle, d’un passage, d’une vibration sensible de la mémoire.
De plus, j’ai décidé de sommer les symboles des cérémonies des revenants où les Egungun, ces figures masquées qui, dans la tradition yoruba, incarnent les revenants et établissent un lien entre les vivants et les morts.
En décidant de broder les sequins des Egungun sur les archives de mes grands-parents, je souhaite invoquer les rites, le prolongement des danses, des chants, des invocations. La photographie en un espace de passage, un seuil par lequel l’héritage familial rejoint une histoire collective, spirituelle et politique.

Commentaires